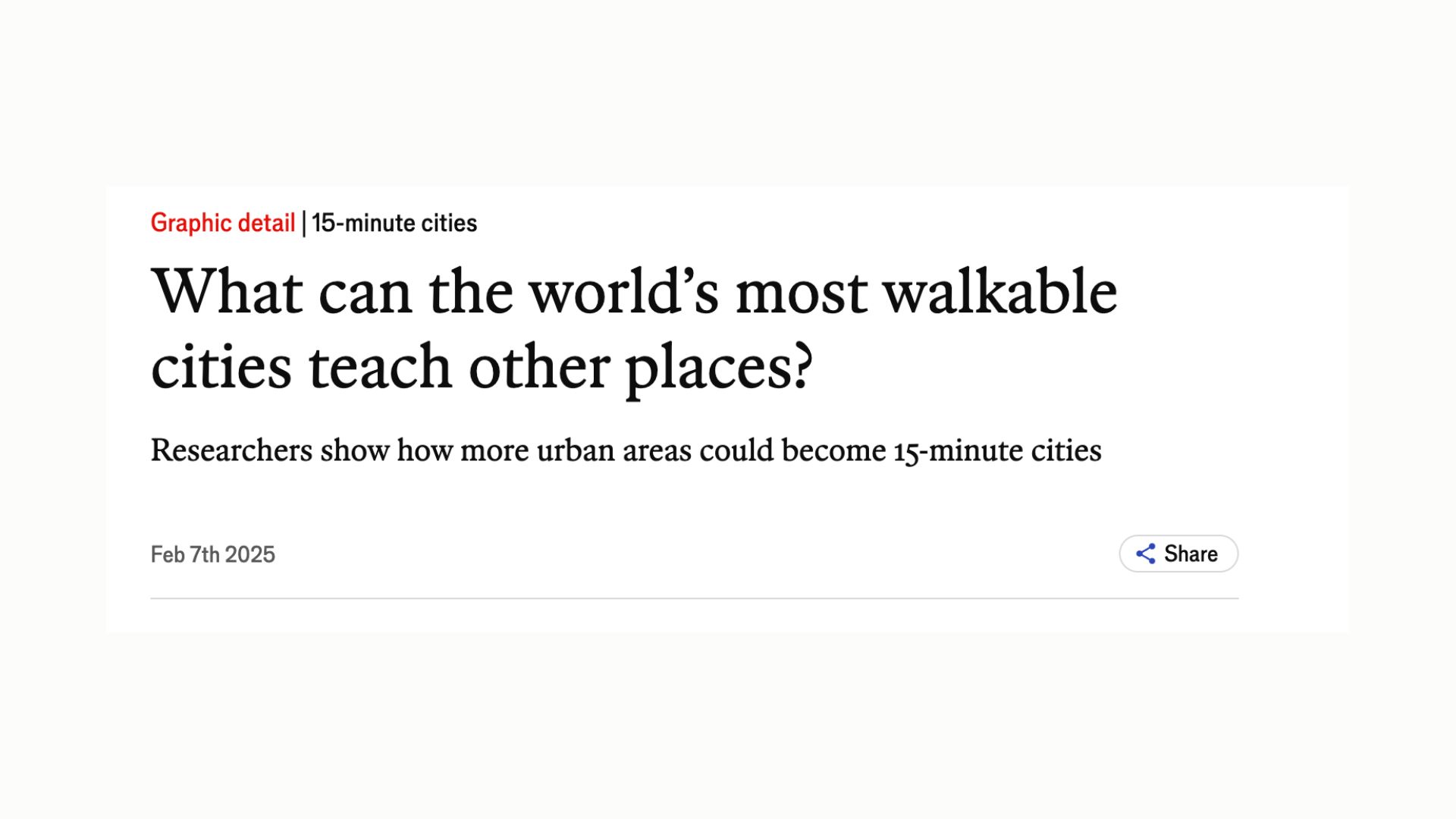Pr. Carlos Moreno a été invité à partager sa vision sur les smart cities dans le cadre d’une interview croisée avec Jérôme Coutant.
Le Professeur Moreno est co-auteur de l’ouvrage collectif “La double compétence : l’antidote à l’obsolescence professionnelle” (FYP Editions). Le livre sera disponible en librairie à partir du 2 janvier 2019. Pr. Carlos Moreno a été invité à partager sa vision sur les smart cities, en tant que Professeur des Universités et expert international. Ce livre donne la parole à des spécialistes reconnus pour mettre en lumière les évolutions et les apports de la double compétence dans cette société en transition par le prisme de leurs domaines d’expertise : monde de l’entreprise (experts en ressources humaines, dirigeants d’entreprises, top managers, startups), médias, institutions publiques, communication, secteurs de la santé et de l’ingénierie, etc.
Smart cities et villes nouvelles, l’espoir de la transversalité
Responsable numérique de la Société du Grand Paris de 2013 à 2018, Jérôme Coutant a débuté sa carrière dans de grandes entreprises avant de rejoindre la Caisse des Dépôts en 2002, puis devient chef du pôle aménagement numérique du territoire de la DATAR en 2007 et membre de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP) de 2011 à 2013.
Professeur des Universités, expert internationalement reconnu, Carlos Moreno est l’un des pionniers de la Smart City avec une vision centrée sur l’humain. Il est notamment à l’initiative du Think Tank Live in a Living City, source de réflexions sur l’évolution la ville. Il a créé et dirige la Chaire Entrepreneuriat Territoire Innovation – ETI – de l’Université Paris1 Panthéon Sorbonne – IAE Paris.
De par son statut, la ville est le berceau naturel de compétences multiples, un patchwork d’identités aux parcours distincts, un assemblage d’une infinie richesse. Mais la ville est aussi le lieu de naissance permanent de problématiques et contraintes liées à l’évolution technologique, aux bouleversements climatiques et aux nouveaux enjeux sociétaux. De ce fait, et même si, comme pour les entreprises, l’évolution se veut inéluctable pour coller au temps présent et futur, changer une ville est un défi sans commune mesure, nécessitant une vision à court et long terme ainsi qu’une cohésion sans faille de toutes les strates de la société, du public au privé. Cette transformation aussi ambitieuse qu’incontournable, la ville de Paris y travaille maintenant depuis plusieurs années via un chantier d’envergure, celui du Grand Paris Express, orchestré par la Société du Grand Paris. Représentant un budget de plus de 38,5 milliards d’euros pour 200 km de lignes automatiques destinées à desservir 68 nouvelles gares à l’horizon 2030, ce métro sera le fruit d’un intense travail technique, mais pas seulement : derrière cette prouesse d’ingénierie reconnue comme le plus grand projet urbain en Europe de ces dernières décennies, se retrouve aussi une intense réflexion sur ce à quoi devra ressembler la ville nouvelle et intelligente et ce que seront ses ambitions citoyennes. Un projet né par et pour la transversalité sur lequel reviennent Jérôme Coutant, responsable numérique de la Société du Grand Paris de 2013 à 2018, et Carlos Moreno, expert international de la Smart City.
INTERVIEW
Qu’est-ce qui vous a poussé à vous diriger vers le domaine de la ville intelligente ?
Carlos Moreno : J’ai commencé à m’y intéresser dès 1998 pour de nombreuses raisons. La première est celle de mon attrait pour la complexité si chère à Edgar Morin, ce grand penseur universel français. La complexité, c’est réfléchir à comment l’on vit dans la ville considérée comme un système de systèmes, à comment s’établissent les interdépendances, à la transversalité, aux émergences… La complexité, c’est le mot latin complexus, le fait de comprendre comment des éléments sont tissés ensemble. C’est aussi être amené à réfléchir à comment s’adapter à des changements profonds et parfois aléatoires. C’est tout cela qui m’amené à réfléchir pour la première fois à une problématique urbaine via les premiers travaux que j’ai menés, liés aux villes à risques aussi appelées Seveso. En tant que scientifique chercheur, j’avais développé une plateforme numérique capable de gérer au niveau de la complexité énormément de capteurs de toute sorte. Nous étions en 1995, Internet n’était pas ce qu’il est désormais, et cette plateforme opérationnelle pouvait gérer un grand nombre de capteurs hétérogènes, mettre des règles et inférences sur des axiomatiques et des raisonnements, faire des prédictions… Elle a d’abord été utilisée dans un système très complexe, celui des générateurs de vapeur de centrales nucléaires, et a connu un certain succès puisqu’elle a été ensuite utilisée dans la sécurité de ce même domaine très longtemps. Par la suite, la plateforme a été utilisée dans le programme naissant des drones de l’armée française, équipés eux aussi de nombreux capteurs, notamment d’image, et ayant besoin d’une structure d’accueil numérique au sol. Puis l’on m’a proposé de travailler sur les villes à risques, mon premier terrain d’expérience. J’ai commencé dans les zones du Havre et Gonfreville-l’Orcher, là où se trouvent notamment l’usine Total et près de 28 sites Seveso dans un tout petit rayon géographique. Les maires des différentes communes m’ont petit à petit demandé si, en plus de gérer les risques, je pouvais également m’intéresser à l’éclairage public – les fils des poteaux électriques, la moyenne tension, la gestion des ballasts électroniques… – pour avoir un éclairage plus intelligent, puis à la gestion de caméras, la détection d’incendies et de fumées…. Un travail qui, plus tard, m’amènera à placer cette plateforme au cœur du grand projet de vidéo surveillance urbaine à Paris et dans de nombreuses autres villes. Je suis ainsi venu à la ville par l’usage et l’expérimentation, en ajoutant les fonctions que les maires me demandaient. C’est ainsi qu’en 2002 j’ai proposé le concept de « ville numérique et durable », car j’avais compris que le numérique, aussi puissant qu’il pût être, n’était pas un gage de performance s’il n’était pas accompagné d’un changement de conduite par rapport aux usages. Que l’on pouvait optimiser tout ce qu’on voulait, de l’éclairage public aux ouvertures-fermetures de portes, mais que cela était impossible avec des comportements d’usage contraires au développement durable, à la lutte pour climat, l’économie circulaire et l’inclusion citoyenne. Face à une approche complètement verticale et techno centrique, il ne fallait plus voir le numérique pour intégrer et solutionner les problèmes de la ville, mais au contraire imaginer autrement la ville, les usages, les comportements, la mobilité, la manière de produire et consommer l’énergie, la manière de travailler, etc. C’est là que j’ai commencé à développer le concept de la ville par les usages.
Jérôme, qu’est-ce qui vous a conduit à devenir responsable numérique de la Société du Grand Paris ?
Jérôme Coutant : Le hasard et la nécessité, selon l’expression du biologiste Jacques Monod. En 2013, après avoir achevé mon mandat au collège de l’Arcep, je cherchais une nouvelle mission de l’État dans le numérique. Le président de la Société du Grand Paris de l’époque, Etienne Guyot, réfléchissait alors à structurer le volet numérique du projet de métro du Grand Paris. Nous en avons parlé et c’était la bonne combinaison. Ce qui ne relève pas du hasard, c’est que ma vie professionnelle a toujours été en lien avec le numérique. Avant de me consacrer à l’action publique, j’ai travaillé pour plusieurs entreprises en rapport avec ce domaine. La dernière a été Motorola. J’y ai passé 7 années pendant lesquelles, avec les opérateurs, j’ai lancé la radiomessagerie grand public, puis l’accès haut débit par les réseaux câblés, quelques années avant l’ADSL. J’ai ensuite dirigé la branche mobile grand public de Motorola au moment où les terminaux étaient prêts pour la 3G et l’Internet mobile. C’était passionnant, car j’étais convaincu que la combinaison de l’Internet, du haut débit et du mobile allait créer un double big bang. En 2002, après avoir monté une start-up, j’ai été recruté pour toute cette expérience par la Caisse des Dépôts qui avait été chargée d’accompagner les collectivités locales sur le développement numérique de leur territoire. J’ai d’abord passé six ans en régions et dans les outremers puis l’on m’a proposé de piloter l’aménagement numérique du territoire à la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale ( DATAR, devenu depuis 2014 le Commissariat général à l’égalité des territoires). Il fallait alors repenser la stratégie de l’État en matière de couverture numérique du territoire à la veille des déploiements des réseaux très haut débit fixe et mobile. Les investissements pour la fibre à l’abonné et la 4G étaient considérables et la logique de marché en vigueur allait inéluctablement accroître le décrochage des territoires ruraux. C’est incroyable de réaliser aujourd’hui que la pensée dominante conduisait inéluctablement vers une France à deux vitesses et le décrochage total des territoires ruraux, c’est-à-dire 80 % du territoire national ! Quelle entreprise aurait survécu ? Qui aurait voulu y vivre, y faire ses études, y travailler ? Je me suis donc employé à renverser la vapeur en proposant une autre stratégie pour équiper la France de ces infrastructures essentielles, conjointement avec les associations de collectivités locales et les parlementaires. Cela m’a conduit au cabinet du ministre de l’aménagement du territoire, puis à l’Arcep, puis à la Société du Grand Paris où j’ai passé 5 ans. Le transport collectif est le socle des villes durables et les synergies avec le numérique sont multiples… Il y a une forme de déterminisme dans tout cela !
Bien que vos profils et parcours soient très marqués par la technique, vous avez réussi à dépasser cela dans vos fonctions respectives.
Carlos Moreno : Je viens effectivement du monde de l’informatique, des mathématiques et de l’électronique et mon poste de Professeur des Universités était dans la section Mathématiques-Informatique. Cependant, par mes travaux scientifiques, j’ai eu la chance de tomber très tôt sur l’axiomatique de la complexité pensée par Edgar Morin et d’autres penseurs, comme Francisco Varela, Henri Atlan, Henri Laborit… Tous disent que l’Homme passe l’essentiel de son temps à séparer ce qui est naturellement lié. En France, qui est un pays d’ingénieurs très cartésien où l’on aime bien la verticalité, les disciplines scientifiques sont séparées en sections quand nous devrions davantage être plus en résonnance entre les sciences dites à tort « dures » et les sciences humaines que dans la séparation. Dans ma vie de scientifique, les équipes et directeurs de laboratoires avec qui j’ai pu travailler m’ont tous amené vers la transversalité. Le seul gage de réussite de la technologie est d’embrasser d’autres disciplines comme la sociologie, l’anthropologie, l’ethnométhodologie et l’étude du comportement pour savoir en quoi cela peut servir les gens. Il y a des technologies jamais utilisées, car nous n’avons pas su faire en sorte que les usagers les adoptent. Par exemple, dans les années 1990, le public n’était pas prêt pour le robot aspirateur, que nous avions développé avec succès – c’était l’un des tout premiers au monde – tandis que, 20 ans plus tard, chacun souhaite en posséder un. Ces robots aspirateurs avaient d’ailleurs été reconvertis par mes soins en équipe de robots footballeurs pour la Robocup de l’été 1998 à la Cité des Sciences de la Villette ! Travailler sur la problématique des villes à risques m’a ainsi permis de m’intéresser à d’autres disciplines que la mienne. Je me suis intéressé à l’urbanisme, à la méthodologie urbaine, au comportementalisme et à l’approche cognitive des usages et cela a complètement transformé ma vie professionnelle. J’ai alors été totalement convaincu qu’une nouvelle technologie ne pouvait être poussée très loin que par la compréhension des usages et l’incitation à démarrer de nouveaux usages… et inversement ! J’ai toujours en mémoire la phrase de Steve Jobs, le cofondateur d’Apple : « Nous sommes capables de produire des objets qui ne servent à rien, mais dont personne ne peut se passer ». J’ai donc voulu réfléchir à inciter l’adoption de nouveaux usages pour des objets servant à quelque chose et pour lequel on transforme vraiment nos vies. Des objets incarnant alors du lien social ! Pour arriver à cela, il ne faut pas seulement connaître les usages d’aujourd’hui : il faut également être en mesure d’anticiper ceux de demain. Cela nous emmène, par exemple, à la mobilité. Ma démarche est de voir quels usages sont anticipables afin d’ensuite identifier parmi les tendances technologies l’option ou les options possibles qui serviront à en faire quelque chose. C’est ce qu’on fait quand on étudie les problèmes de la multimodalité, quand on s‘intéresse à la problématique du transport à la demande ou aux nouveaux modes de transport. Il faut pour autant dépasser la fonction en elle-même et se dire, par exemple, que la question de la mobilité est un lien entre l’individu et son territoire. D’où ma notion de « la ville du quart d’heure » qui consiste à dire que la meilleure des mobilités est l’immobilité : il s’agit alors de sortir de la mobilité subie, d’avoir à se déplacer que si on le souhaite. Ce concept de chrono urbanisme de nouvelle génération qui tend vers la « ville complète » s’articule de façon à ce que chacun puisse avoir accès à toutes les fonctions essentielles de vie – primaire, secondaire et tertiaire (se loger, travailler, se soigner, s’épanouir…) à un quart d’heure de lui. Voilà pourquoi je suis persuadé de l’importance des rencontres et de l’interdisciplinarité pour faire émerger des concepts nouveaux. Nous avons autant besoin de sociologue et de psychologique que de technologues ! Par contre, il faut bien avoir conscience de la puissance du numérique car, sans lui, pas de disruption possible des usages !
Jérôme Coutant : Sans pour autant être ingénieur ni scientifique, le numérique a toujours été ma passion. De ce fait, j’ai toujours eu un regard généraliste. D’ailleurs, à partir du moment où j’ai été en pilotage d’un projet, comme celui de la Société du Grand Paris, j’ai toujours considéré mon rôle comme celui d’un animateur. Pour mener de tels chantiers, il faut – je le crois – un regard pluridisciplinaire. Par ailleurs, je sais que l’expertise dans un domaine où les technologies évoluent rapidement est du côté des entreprises, notamment chez les opérateurs. Il y a en France une richesse et une profusion d’acteurs capables d’anticiper l’innovation technologique et l’évolution des usages. Il faut les écouter ! Mon rôle pour concevoir le volet numérique du Grand Paris Express a donc consisté à faire s’exprimer les acteurs sur leur vision d’un métro à l’ère numérique et à en faire la synthèse pour en tirer un chemin d’intérêt général. Dans le domaine des réseaux, il ne faut surtout pas faire des choix technologiques qui freineraient l’innovation des opérateurs de services, ce serait absurde. Le métro est un service public, il faut faire attention à ne pas verrouiller son environnement numérique et technologique, mais l’ouvrir au maximum. Par ailleurs, il y a l’enjeu de la donnée. Le Grand Paris Express comporte 67 nouvelles gares et près de 200 km de tunnels desservant des territoires urbains très variés. Or, cette infrastructure physique va être dotée de multiples capteurs de fonctionnement, mais aussi de réseaux avec lesquels les voyageurs vont interagir, comme le Wi-Fi ou la géolocalisation. Tout ceci va produire une quantité exponentielle de données au fur et à mesure où la confiance des voyageurs dans l’utilisation faite de leurs données va s’installer. Imaginez, 3 millions de voyageurs par jour, cela représente près de 1 milliard de voyages par an parmi lesquels une bonne centaine de millions de visiteurs internationaux ! Ce métro va donc devenir un véritable hub de données à une échelle sans précédent. L’enjeu est considérable et suscite beaucoup de questions. Que va-t-on faire de ces données ? Comment les partager avec celles des collectivités et des entreprises ? La puissance publique n’a-t-elle pas un rôle à jouer dans la gestion des données produites par un service public de transport ? N’est-ce pas le champ d’expérimentation idéal sur ce que pourrait être un « service public de la donnée » ? Nous avons commencé à mener des réflexions, dans un contexte plus large où chacun voit bien que les grandes plateformes numériques nord-américaines et asiatiques ont un quasi-monopole de l’exploitation de nos données, parfois aux dépens des services publics. Avec le Grand Paris Express, nous avons une occasion historique, en tout cas centennale, de réfléchir et d’agir sur l’utilisation des données à des fins d’intérêt général et de développement local. Mais ce sujet n’est pas simple à faire avancer dans le contexte du projet du Grand Paris Express. La Société du Grand Paris est en effet déjà dans une tension extrême pour mener à bien la mission que l’État et la loi lui ont confiée, c’est-à-dire construire le réseau de transport. En tout cas, il me semble urgent que soit nommé un administrateur des données avec une mission claire, sur le modèle de celle mise en place au niveau de l’État et de la plupart des organisations publiques et privées. Il y a tellement d’acteurs locaux innovants qui pourraient tirer parti de ce « bien commun » !
Carlos Moreno : Un projet comme celui du Grand Paris Express va transformer l’approche de la mobilité dans l’une des plus grandes régions d’Europe et sera traversé par un flux numérique d’une puissance énorme. C’est un chantier gigantesque. Il faudra arriver à transformer le risque en opportunité et c’est le rôle des décideurs. Énormément de fois en France, on a échoué, car on était tétanisés par le risque. On a donc pris des mesures coercitives, paralysés par cette « puissance de feu » que représentent les données. En France, nous n’avons pas encore pleinement intégré la force que représentent les administrateurs de données et le fait de pouvoir canaliser ce flux pour faire émerger de nouveaux usages et services. Dans certains pays anglo-saxons, par le libéralisme économique et cette espèce de mouvement brownien souvent sauvage, on voit l’émergence de nouveaux usages utilisant les données en grande quantité et Google en est le parfait exemple, mais il s’agit en grande majorité d’initiatives privées. Là, il s’agit d’amener des initiatives publiques, pour faire en sorte que le numérique devienne générateur de création de valeur, de richesses et de services tout en étant complètement imbriqué dans la plus grande infrastructure jamais créée en France, dotée d’un budget de près de 40 milliards d’euros pour une mise à disposition dans un délai très court – 2030, c’est déjà demain – et qui touchera 12 millions de personnes. Forcément, cela demande de prendre des risques. Certes, ce n’est pas facile dans un pays d’ingénieurs comme la France où les gens vont d’abord s’occuper à savoir comment faire les tranchées, éviter les écueils géologiques et topologiques ou amener la ventilation et les tunneliers. Encore aujourd’hui, cette dimension numérique reste très immatérielle pour beaucoup d’ingénieurs : ils préfèrent se dire « on verra ça après », sauf qu’après, ce sera trop tard ! Quand on me demande comment peut-on être capable de prendre des risques, je réponds que ce n’est pas la bonne question, car imaginer de nouveaux services avec de très forts investissements financiers, physiques ou immatériels engendre toujours des risques. La prise de risque est inhérente à toute disruption, toute innovation. Il y a toujours des risques d’échec, de mauvaise compréhension, d’être sur une tendance qui n’est pas la bonne. Non, la vraie question c’est : quel que soit mon risque, petit ou grand, comment je peux le faire devenir une opportunité porteuse de valeurs ? Ces valeurs doivent être pensées à trois niveaux : économique, pour créer de la richesse et une meilleure capacité compétitive ; sociale, pour créer de l’inclusion sociale, mieux vivre ensemble et améliorer la qualité de vie ; et écologique, pour lutter contre le changement climatique, qui est l’impératif, notre urgence et défi majeur, l’accompagner d’un nouveau paradigme énergétique et participer à la transformation de nos modes de production-consommation. C’est le souci de l’ingénierie, trop souvent cantonnée au risque technologique sans prendre en compte cette triple dimension, cette convergence nécessaire. Je l’ai vécu en tant que penseur de la ville et sur différents projets que j’ai pu mener ou que je mène encore en tant que scientifique ou à travers la voie industrielle ou entrepreneuriale.
Jérôme Coutant : La ville on peut toujours y revenir : demain, on peut décider de casser une rue et refaire autre chose. Mais avec le Grand Paris Express, on ne pourra pas. C’est aussi pour ça que ce projet est un laboratoire. Au tout début des études de conception du métro, nous nous sommes posé la question du cheminement des câbles de fibre optique. On peut évidemment disposer les câbles sur des crochets, mais les opérateurs télécoms nous ont dit qu’ils préféraient ne pas intervenir dans l’espace occupé par les trains, et on les comprend. D’où l’idée de disposer les câbles dans des fourreaux et de placer ceux-ci dans le béton sous les voies du métro ou le long des voies. Par ailleurs, dans 30 ou 50 ans, les usages numériques dans le métro auront radicalement évolué. Mis à part la fibre optique qui a une très forte pérennité, on sait déjà que les technologies de transmission vont évoluer et se multiplier. Le Li-Fi est déjà un bon exemple. Pour faire bénéficier les voyageurs de ces vagues d’innovation qui vont se succéder, il faudra pouvoir accueillir de nouveaux équipements et de nouveaux acteurs. Il faudra donc des espaces sécurisés, raccordés en énergie et en fibre optique. Après avoir pris l’avis d’un très grand nombre d’acteurs technologiques, c’est ce que nous avons prévu dans chacune des 68 gares et dans la plupart des puits de sécurité tous les 800 mètres. Tout ceci pour dire que, bien qu’étant différents, les sujets de l’infrastructure et de l’usage doivent être pensés et planifiés – si tant est que cela soit possible dans le cas des usages – de manière indépendante. Pour les usages, le terme de « planifier » n’est pas le bon d’ailleurs : il faut plutôt les rendre possibles par un processus d’innovation ouverte, en permettant aux développeurs et designers de services de s’approprier cette plateforme numérique que constituera le métro. Les services seront imaginés au fur et à mesure, suivant les besoins que rencontreront les voyageurs. Mais les mesures conservatoires, elles, doivent être prises dès le départ. C’est une lourde responsabilité.
La ville intelligente transpose-t-elle les concepts de transversalité et de « management horizontal agile » dans la vie quotidienne ?
Jérôme Coutant : La façon dont est mené le projet du Grand Paris Express est certainement plus horizontale que verticale même s’il s’agit d’un projet d’intérêt national piloté par l’État, car il conditionne le futur de la région capitale. Bien qu’étant, au fond, un projet très régalien dont on sait qu’il va bénéficier aux autres régions par capillarité, il fonctionne via un modèle collaboratif, en impliquant pas à pas les collectivités locales à chacune des étapes, y compris dans le choix de l’emplacement précis des ouvrages ou dans le choix des architectes des gares. C’est en cela que l’on peut parler de gestion horizontale et agile de ce projet, même si c’est loin d’être simple de créer un consensus avec les acteurs locaux franciliens sur un projet aussi perturbant pour eux. Lyon, Marseille ou Toulouse ont mené des projets analogues, mais à une échelle différente, avec une gouvernance plus simple. Sur le volet numérique du projet, la gestion est tout aussi horizontale et collaborative : l’interaction avec les collectivités est très forte depuis 5 ans avec l’enjeu d’irriguer les territoires desservis par le Grand Paris Express via les réseaux numériques qui équiperont le métro. C’est un peu la déclinaison du modèle mis en place au niveau national sur les réseaux à très haut débit : l’État planifie et organise la couverture intégrale et cohérente du territoire, avec un mécanisme de soutien financier pour ne laisser aucun territoire et ses habitants de côté ; les collectivités locales définissent les priorités et réalisent les projets. L’interaction avec les collectivités locales est intense et quotidienne. Ce métro et son volet numérique ne se seraient jamais faits sans leur participation.
Cette horizontalité va bénéficier aussi aux Franciliens par la configuration même du Grand Paris Express. C’est un métro en rocade qui va permettre d’éviter de passer systématiquement par Paris. C’est un renversement dans le sens où cela va permettre à chaque banlieue de devenir un centre, un pôle d’attractivité avec ses propres atouts. L’opposition Paris-banlieues laisse la place au polycentrisme, la métropole étant constituée d’un archipel de territoires riches de potentiels, même si Paris est à part. Côté numérique, cette grande rocade va également apporter à chacun de ces territoires l’accès direct à des ressources numériques de très grandes puissances : un pipeline de fibre optique et des salles d’hébergement numérique. C’est l’opportunité de rééquilibrer l’attractivité de ces territoires, notamment numérique. Et c’est logique, car le Grand Paris est un projet politique qui doit conduire à un rééquilibre entre toutes ses composantes. On sait très bien qu’entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud, il y a de grandes inégalités dans l’accès à l’emploi dès lors que les entreprises ne trouvent pas l’environnement qui leur est indispensable. Et pour revenir au concept de ville numérique et durable porté, le « durable » inclut le bien-être et, par conséquent, l’éducation et l’accès à l’emploi – je vis ici, mais est-ce que je bénéfice de tout ce que territoire peut apporter à des gens ayant plus de moyens que moi ? L’aspect politique est là : c’est un vrai projet de rééquilibrage des chances, ce qui démontre que le mot « transversalité » peut s’entendre de différentes manières. Une agglomération de 12 millions de personnes qui ne bénéficient pas, selon leur lieu de vie, des mêmes chances d’accès à l’emploi est une agglomération qui boite et où les relations se tendent. Et tant que le Grand Paris Express ne sera pas opérationnel, ces inégalités vont encore s’accentuer.
Carlos Moreno : Nous devons nous démarquer d’une vision néo-positiviste, qui laisserait croire que la ville intelligente en tant que progrès technique va apporter des solutions à tous les problèmes des villes. En revanche, toute la réflexion dans laquelle je me suis plongé depuis pas mal d’années sur la ville intelligente dite humaniste, c’est-à-dire centrée sur le citoyen, nous permet de mieux penser les réponses aux problèmes actuels des villes. C’est donc là qu’il faut aller chercher des solutions. La ville, qui est constituée d’un grand nombre de systèmes interdépendants, constitue un espace territorial au centre duquel le citoyen évolue. C’est pourquoi toute réflexion sur les projets urbains, l’intelligence sociale, la technologie numérique au service du citoyen et la construction de la résilience de la ville exige des pratiques transversales – qui elles seules vont permettre d’innover, d’expérimenter, d’explorer les relations qui existent entre l’espace public de la ville, ses infrastructures ainsi que ses exigences publiques et privées de développement.
Imaginer les gares, par exemple, c’est imaginer l’accès à la culture, aux échanges, à la formation, à du brassage… C’est aussi lutter contre l’exclusion aussi bien sociale que climatique et se battre pour l’équité. Il ne s’agit pas d’une question strictement d’égalité, car les chances ne peuvent pas être d’une même nature selon que l’on habite à l’Est, à l’Ouest, dans le 93 ou dans le 92 : on doit donner un privilège à des zones défavorisées pour offrir des clés d’accès qui, d’ici 10 ans, permettront de désamorcer des situations destinées à être de plus en plus tendues. Cet aspect fondamental renvoie aux propos de Jérôme sur l’importance de la concertation menée avec les gouvernances locales dans le cadre du projet du Grand Paris Express. L’État ne peut assumer son rôle de planificateur qu’à partir du moment où il prend racine dans la vie locale et tisse des liens avec les citoyens et les acteurs de l’économie.
Jérôme Coutant : D’une façon générale, le dialogue et le mode collaboratif ont la vertu d’associer et de fédérer. C’est une démarche rarement, voire jamais pratiquée dans l’ingénierie ferroviaire ou le bâtiment, mais elle est en revanche très naturelle sur le numérique et c’est pourquoi nous avons entretenu cette conversation depuis près de 5 ans. Toutes les grandes entreprises et opérateurs du numérique, de la ville, de l’énergie et des transports, mais aussi des collectivités, des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des associations et des designers de services y ont participé… leur point commun est de croire en l’utilité d’une démarche d’intégration du numérique en amont dans la conception d’une grande infrastructure de transport public. Cela dit, bien avant mon arrivée, de nombreuses personnes y ont développé des réflexions très innovantes sur les futurs services en gare, sur la place de la culture, sur le renouveau urbain autour des gares, et bien entendu sur l’expérience vécue par les générations futures quand ils prendront ce métro, car c’est à elles que nous devons penser. Ce regard transversal est au cœur de la démarche de la SGP.
Co-auteurs du livre (de gauche à droite) : Joël de Rosnay, Fred Courant, Catherine Ladousse, Arthur Quérou, Cécile Frankart, Valérie Pham-Trong, Guy Vallancien, Bertrand Bailly, Christian Dedieu, Pierre Auberger, Laure Lucchesi, David Layani, , Marc Drillech, Caroline Dalqué-Marty, Carlos Moreno, Jérôme Coutant, Fabrice Bardèche